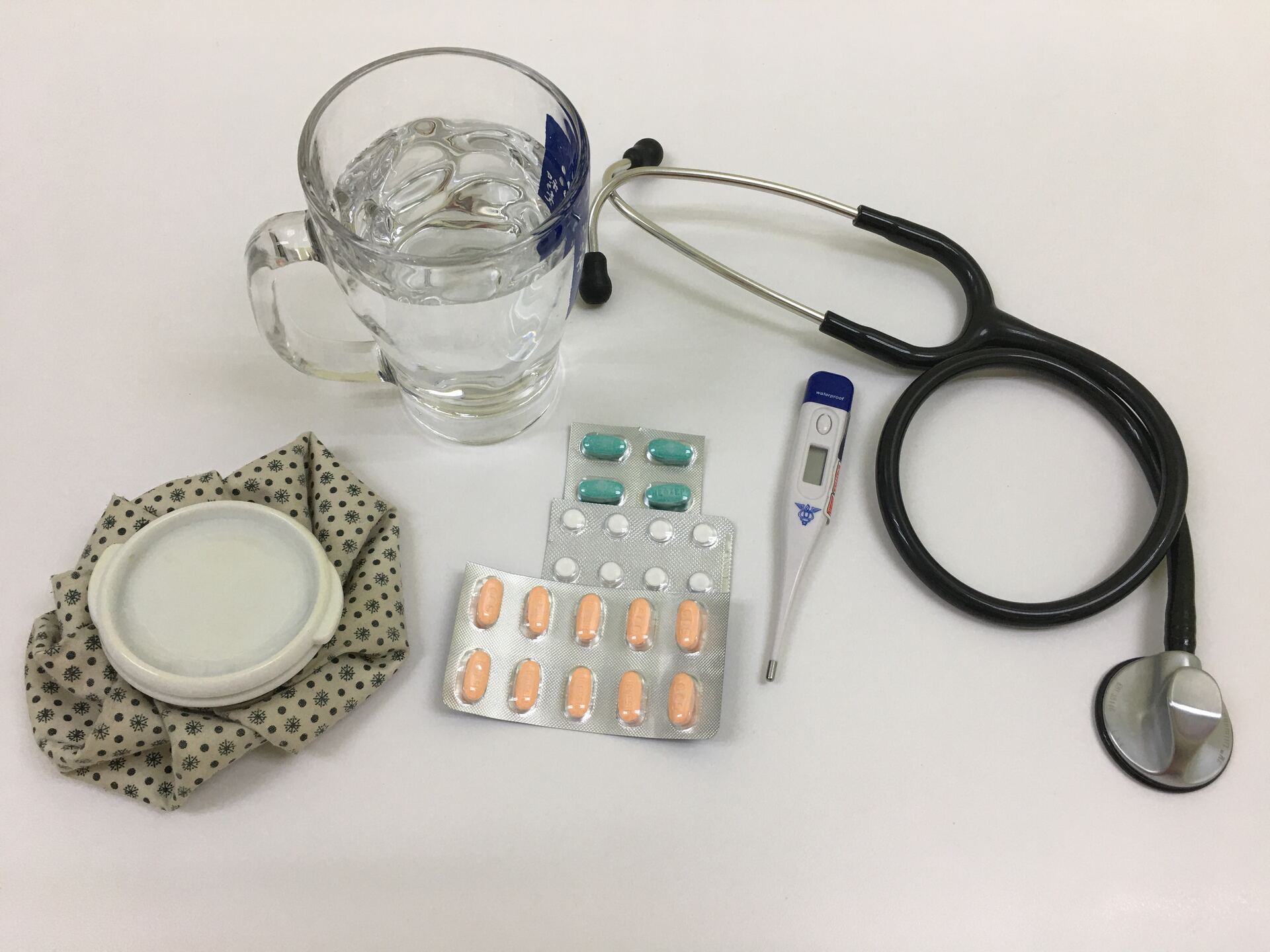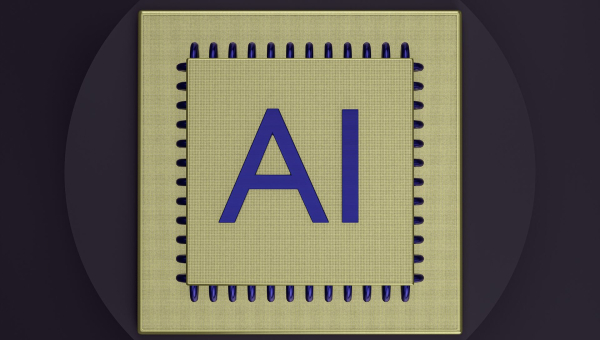Le respect des délais de paiement n’est pas qu’une simple formalité comptable. Ces derniers représentent le ciment des relations commerciales puisqu’ils prouvent la volonté des parties de respecter les transactions convenues. Mais ces échanges peuvent parfois être complexes, notamment en matière de délais. Les législations en vigueur sont différentes en fonction du secteur d’activité, ce qui peut rendre difficile leur compréhension. Petit tour d’horizon des délais de règlement dont le plafonnement est fixé par les articles L441-10 et suivants du code de commerce.
Le fonctionnement des délais de paiement
Les délais de règlement représentent le laps de temps convenu entre les entreprises pour effectuer le paiement après réception des biens ou à la fin des services rendus.
Les délais de règlement entre entreprises sont normalement fixés à 30 jours à partir du moment où les marchandises sont reçues ou les services sont entièrement exécutés.
Cependant, ce délai peut être prolongé jusqu'à 60 jours dans certains cas particuliers, notamment lorsque le contrat signé par les deux parties le stipule. D’autre part, les entreprises ont la possibilité de convenir d’un délai de paiement différent du délai standard si les deux parties signent des accords à ce sujet. Elles peuvent ainsi prévoir de fixer un délai de paiement allant jusqu’à 45 jours à la fin du mois. Autrement dit, si une facture est émise à une date donnée au cours du mois, le délai de paiement de 45 jours commence à partir de la fin de ce mois-là.
A noter : il est impératif que cette modalité de paiement soit explicitement spécifiée et acceptée par les deux parties lors de la rédaction du contrat. Par ailleurs, le délai de paiement doit obligatoirement figurer sur la facture et dans les conditions générales de vente (CGV). Cette clause permet aux entreprises d’adapter les délais de paiement à leurs besoins, mais elle doit être clairement énoncée pour éviter toute ambiguïté.
Attention, tout dépassement de ces délais établis peut entraîner des pénalités financières, des intérêts de retard ou d'autres sanctions. Ces pénalités sont mises en place pour inciter le respect des délais et garantir de bonnes relations entre les entreprises.
Les délais spécifiques aux entreprises de certains secteurs d’activités
Certains secteurs d’activités disposent de délais spécifiques pour les règlements. Par exemple, dans le domaine du transport (location de voitures avec ou sans conducteur, transport routier de marchandises, commissionnaire de transport, transitaire, agent maritime, fret aérien, courtier de fret, commissionnaire en douane…), les délais ne peuvent pas dépasser la période de 30 jours à partir de la date de la facturation. Cette distinction est importante car elle implique que le décompte du délai de paiement débute à partir de la date de l'émission de la facture, et non plus à partir du moment où les biens sont reçus ou les services terminés.
D’autres délais spécifiques s’appliquent à certains secteurs :
Pour les produits alimentaires périssables comme les viandes congelées, les poissons surgelés, les plats cuisinés et les conserves fabriquées à partir de produits alimentaires périssables, le délai de règlement est de 30 jours après la fin de la décade de livraison.
Pour la vente de bétail sur pied destiné à la consommation et pour les viandes fraîches, le délai est de 20 jours après le jour de livraison.
Du côté des boissons alcoolisées, le délai est de 30 jours après la fin du mois de livraison.
Enfin, pour les raisins destinés à l’élaboration de vins, le délai est de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.
Ces délais spécifiques permettent d’adapter les périodes de paiement aux particularités de ces secteurs.
Types de délais de paiement
La négociation des délais se fait lors de la rédaction des contrats, avant la signature des parties. Il existe différentes options de paiement pour les entreprises qui peuvent ainsi choisir en fonction de leurs besoins.
Paiement comptant : Cette option demande le règlement de la somme immédiatement après la réception de la facture pour un règlement rapide et intégral.
Paiement à réception : Dans ce cas, le paiement doit être effectué au moment de la réception de la facture par l’acheteur.
Paiement par défaut : Il s'agit du délai standard de 30 jours à partir de la réception des biens ou de la fin de l’exécution de la prestation.
Paiement négocié : Cette solution permet d’étendre le délai de règlement au-delà des 30 jours classiques. Les entreprises peuvent négocier des délais de paiement prolongés allant jusqu'à 60 jours, en fonction des accords.
Chacune de ces modalités offre aux entreprises certains avantages leur permettant de gérer leur trésorerie et leur politique financière. Toutes ces options ont pour but d’adapter les conditions de paiement à la fois aux besoins de chaque entreprise et aux exigences des transactions commerciales.
Sanctions et litiges
Le non-respect des délais de paiement entraîne des sanctions. En cas de retard de paiement, des amendes administratives peuvent atteindre 2 millions d'euros, parfois plus en cas de récidive.
Ces sanctions sont mises en œuvre par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) et sont rendues publiques conformément à la loi Pacte de 2019 dans le but de dissuader les entreprises de retarder délibérément leur paiement.
En cas de litige lié à des retards de paiement, un médiateur des entreprises peut intervenir pour faciliter la résolution des différends. Il agit comme un tiers neutre et impartial et offre un cadre propice à la négociation et à la médiation entre les entreprises impliquées. Il a pour rôle de favoriser le dialogue et de trouver des solutions acceptables pour les deux parties.
Ces mesures visent à dissuader les entreprises de ne pas respecter les délais de paiement établis et à offrir des mécanismes pour résoudre les litiges et encourager le respect des obligations.
Pour conclure
Pour garantir des relations commerciales justes et sans accroc, la loi encadre les délais de paiement entre entreprises. Par défaut, le délai est de 30 jours à partir de la réception des biens ou de la fin des services. Mais la loi autorise des extensions de délais jusqu’à 60 jours à partir de la date d’émission de la facture. Cette prolongation est possible, mais doit être clairement stipulée dans le contrat et acceptée par les deux parties. Une variante est permise avec un délai de 45 jours fin de mois dans certaines conditions. En cas de non-respect des règles, des sanctions sont applicables.